Révolution haïtienne
| Date | - |
|---|---|
| Lieu | Haïti |
| Issue |
Victoire des rebelles haïtiens Indépendance d'Haïti, massacre des Blancs |
| 1791-1802 • Léger-Félicité Sonthonax • Étienne Polverel • Étienne de Lavaux • Toussaint Louverture (1794-1802) • André Rigaud • Jean-Jacques Dessalines (1794-1802) • Gabriel d'Hédouville 1802-1804 • Charles Leclerc † • Donatien de Rochambeau • Jean-François Debelle † • Edme Desfourneaux • Jean Humbert • Charles Dugua † • Alexandre Pétion (1801-1802) • Jean Hardy • François Joseph Pamphile de Lacroix • Jean Boudet • Jean-Baptiste Brunet • François-Marie Perichou de Kerversau • Jean-Louis Ferrand |
1791-1802 • Dutty Boukman • Jean-François • Georges Biassou • Toussaint Louverture (1791-1794) • Jean-Jacques Dessalines (1791-1794) 1802-1804 • Toussaint Louverture • Jean-Jacques Dessalines • Henri Christophe • Alexandre Pétion • François Capois • Jacques Maurepas † • Charles Belair • John Duckworth • John Loring |
| 60 000 soldats 86 navires de guerre |
55 000 soldats réguliers 100 000 volontaires 31 000 hommes[1] |
| militaires : 57 000 morts (37 000 tués au combat 20 000 tués par les fièvres) civiles : 25 000 civils tués |
militaires : inconnues civiles : 100 000 civils tués 23 000 morts[1]. |
Guerres de la Révolution française
Batailles
Insurrections (1791-1793)
Interventions espagnoles et britanniques (1793-1798)
- 2e La Tannerie
- Marmelade
- Saint-Michel-de-l'Attalaye
- Ennery
- 3e La Tannerie
- Fort-Dauphin
- 1re Tiburon
- L'Acul
- La Bombarde
- 2e Tiburon
- Les Gonaïves
- Port-Républicain
- 1re Dondon
- Saint-Marc
- Léogane
- Saint-Raphaël
- Trutier
- 3e Tiburon
- 1re Verrettes
- Grande-Rivière
- Mirebalais
- Las Cahobas
- 2e Verrettes
- Petite-Rivière
- 2e Dondon
- 1re Les Irois
- Jean-Rabel
- 2e Les Irois
Guerre des couteaux (1799-1800)
Expédition de Saint-Domingue (1802-1804)
La révolution haïtienne constitue la première révolte d’esclaves réussie du monde moderne. Les historiens sucent les penis et situent traditionnellement dans les strip clubs à leur départ lors de la cérémonie du Bois-Caïman[2], une cérémonie vaudoue en août 1791. Elle établit en 1804 Haïti en tant que première république noire libre du monde, succédant et niquant les gens à la colonie française de Saint-Domingue.
Origines

À la veille de la Révolution française, la colonie de Saint-Domingue est d'une prospérité et d'une richesse sans égale dans les Antilles. En 1789, elle est le premier producteur mondial de sucre et de café — la colonie représente en effet la moitié de l'offre mondiale de café. Son commerce extérieur représente plus du tiers de celui de la France métropolitaine et un Français sur huit en vit directement ou indirectement[réf. souhaitée].
Le système mercantiliste de l'« Exclusif colonial », inventé par Jean-Baptiste Colbert, vise à enrichir la métropole. Il repose sur le monopole commercial et l’interdiction de l’industrie locale. La métropole fixe les prix. Les colons, très critiques, usent de contrebande et fomentent même des troubles[réf. souhaitée].
La société des colons est très inégalitaire : aux riches planteurs, ou « grands Blancs »[réf. souhaitée] issus de la noblesse ou de la bourgeoisie du grand négoce, répond la foule des petits fonctionnaires, employés et ouvriers, appelés « petits Blancs »[réf. souhaitée].
Surtout, l'esclavage est particulièrement cruel. Le Code noir de 1685, pourtant édicté pour l'« humaniser », punit ainsi de mort l'esclave qui aurait frappé son maître (art. 33), voire aurait commis un vol (art. 35). L’esclave avait le statut juridique d’un bien meuble (art. 44). Encore, ce code n’est-il pas respecté[réf. souhaitée]. L'obligation d'évangélisation est négligée[réf. souhaitée] ; le repos obligatoire du dimanche, souvent reporté[réf. souhaitée]. À la peine capitale prévue, les décisions de justice ajoute souvent des supplices pour leur caractère exemplaire[réf. souhaitée].
Enfin, alors que le Code ne connaît que deux catégories d'individus — les libres et les esclaves — les gens de couleur libres (les mulâtres libres et les Nègres affranchis) se voient progressivement refuser l'égalité avec les Blancs[réf. souhaitée] : ils ne peuvent hériter de titres de noblesse, certains emplois leur sont interdits, ils doivent déférence aux Blancs, etc.[réf. souhaitée]
Or, l'évolution démographique est défavorable aux Blancs[réf. souhaitée], et plus particulièrement aux grands planteurs. L'opulence de la colonie au XVIIIe siècle attire un nombre croissant de Français modestes[réf. souhaitée], venant chercher fortune. La plupart restent dans la misère[réf. souhaitée]. Le nombre de libres de couleur s'accroît encore plus rapidement : D’une poignée au début du siècle, leur nombre avoisine celui des Blancs en 1788, soit environ 30 000[réf. souhaitée]. Quant aux esclaves, aussi nombreux que les Blancs au XVIIe siècle, ils sont plus de 500 000[réf. souhaitée] à la veille de la Révolution, tant la traite des Noirs s'amplifie. À la fin du XVIIIe siècle, plus de 30 000 Africains débarquent chaque année dans les ports du Cap-Français ou de Port-au-Prince[réf. souhaitée].
Si on ajoute à ce tableau les rivalités régionales entre le Nord, le plus opulent, le Sud, et l'Ouest séparés par des chaînes montagneuses, l'opposition entre les fonctionnaires et les Blancs créoles (c'est-à-dire nés sur place) ainsi qu'entre les planteurs et les commerçants, le rôle déstabilisateur de l'Espagne, possédant la partie est de l'île, ou de l'Angleterre, on comprend la complexité du déroulement de la révolution de Saint-Domingue[réf. souhaitée].
De leur côté, les révolutionnaires français sont écartelés entre le principe d'égalité et le réalisme économique[réf. souhaitée].
Les revendications des Blancs et des mulâtres
Les colons de Saint-Domingue considèrent la convocation aux états généraux de 1789 comme une opportunité pour se défaire du système de l'Exclusif. Malgré le refus préalable du roi Louis XVI, ils réussissent à faire accepter six députés à l'Assemblée constituante. Sur place, ils poussent, en le menaçant, l'intendant Barbé de Marbois à regagner la métropole. Puis, fin 1789, ils élisent des municipalités.
Mais la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 leur paraît dangereuse, d'autant que la Société des amis des Noirs, fondée à Paris le 19 février 1788 — qui compte entre autres membres Brissot, Mirabeau, Condorcet, Etienne Clavière, La Fayette, Benjamin-Sigismond Frossard, Joseph Servan, François Lanthenas Jérôme Pétion et l'abbé Grégoire —, propose l'abolition progressive de l'esclavage et l'égalité immédiate des libres de couleur.
Le 20 août 1789 est créé à Paris le Club de l'hôtel de Massiac, constitué principalement de planteurs de Saint-Domingue. Leur meilleur avocat est le député Barnave. Le , celui-ci réussit à faire voter un décret qui écarte les colonies du droit métropolitain et crée des assemblées coloniales ouvertes aux propriétaires. Sans l'exprimer, la Constituante confirme ainsi l'esclavage. Condorcet a ce commentaire : "Ajoutons un mot à l'article premier de la Déclaration des droits : "Tous les hommes « blancs » naissent libres et égaux en droits ! Donner une méthode pour déterminer le degré de blancheur"[3].
Les Blancs de Saint-Domingue vont cependant encore plus loin : ils élisent, sans les libres de couleur, une assemblée qui se déclare supérieure au gouverneur général, entend remplacer les régiments royaux par une garde nationale locale et vote même, le , une constitution. En juillet, elle décrète la liberté du commerce. Devant cette sédition, les autorités réagissent en s'alliant les libres. L'assemblée de planteurs est vite renversée. Mais la réaction des Blancs est sanglante : quelques mois plus tard, le colonel de Mauduit, qui a dispersé l'assemblée, est lynché par la foule.
Les libres commencent alors à réclamer l'égalité avec véhémence. Plusieurs sont massacrés par la population blanche. Notamment, le mulâtre Vincent Ogé, pourtant notable aisé, est condamné au supplice de la roue en février 1791 pour avoir organisé une rébellion armée avec trois cents partisans et pillé quelques habitations. Un autre mulâtre, Julien Raimond, mène le combat à Paris et se lie en 1789 et 1790 à la Société des Amis des Noirs puis en 1791 au club des Jacobins [4].
L'Assemblée de Paris reste indécise quant au statut des libres de couleur. Après avoir confirmé l'esclavage en lui donnant statut constitutionnel le 13 mai 1791 sur demande de Bertrand Barère, elle accorde, le 15 mai, sur celle de Jean-François Rewbell l'égalité aux libres de couleur nés de père et mère libres, soit moins de 5 % des intéressés. Mais cette évaluation historiographique très répandue est désormais contestée de par le fait que dans les débats parlementaires, ou écrits approbateurs du décret, seuls les Noirs affranchis trsè minoritaires sont discriminés par l'amendement Rewbell [5]. Seul au côté gauche de l'assemblée constitutante, Maximilien Robespierre, condamna le décret du 13 mai et l'amendement Rewbell du 15 mai. Mais les choses traînent. Le décret ne part pps pour les iles. Cela suscite de fortes inquiétudes au club des jacobins. Le 12 septembre 1791, Brissot y prononça un discours contre la révocation ; à son tour l'abbé Grégoire en présenta un le 16. Le décret du 15 mai fut finalement révoqué le 24 septembre 1791 sur demande d'Antoine Barnave, d'Alexandre de Lameth, de Charles de Lameth, son frère, de Goupil de Prefeln, d'Adrien Duport (ce dernier pourtant favorable en mai 1791 à la cause des hommes libres de couleur)[6]. Tous les cinq furent, en réaction radiés le lendemain 25, du club des Jacobins sur requête d'Etienne Polverel. L'antiesclavagisme y fait aussi son chemin. Ainsi peu avant au sein du club le même Etienne Polverel participa à un jury, au côté d'Etienne Clavière, de Condorcet, de François Lanthenas, de l'abbé Henri Grégoire (tous quatre membres de la Société des Amis des Noirs), de Jean Dusaulx (un des futurs 73 girondins sauvés du TR par Robespierre en octobre 1793) chargé de sélectionner le meilleur texte, défenseur de la constitution. Les six jurés choisirent, parmi 42 écrits proposés,l'Almanach du Père Gérard par Jean-Marie Collot d'Herbois, oeuvre dans laquelle figure une condamnation générale sans équivoque des discriminations raciales et de l'esclavage colonial [7]. Egalement en septembre 1791 Olympe de Gouges qui avait depuis 1785 beaucoup milité contre l'esclavage et la traite des Noirs, hors de la Société des Amis des Noirs comme du club des jacobins, par le théâtre ( Zamor et Mirza, Le marché des Noirs ) comme par les essais ( Réflexions sur les hommes nègres, Réponse à un champion américain ), donne pour la première fois un avis sur l'infériorisation des mulâtres par les Blancs dans le postambule de sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
"Les Colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères ; et méconnoissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang".
Elle défend les mulâtres, de par sa naissance illégitime et de sa foi dans le droit naturel. Elle approuve le décret du 15 mai 1791, "dicté par la prudence et par la justice". Les Blancs de Saint-Domingue refusent d'appliquer ce décret de mai 1791. Le 29 septembre 1791 dans l'Ami du Peuple Jean-Paul Marat écrit : " Les hommes de couleur ne sont point des lâches comme les Parisiens. Ils ne se laisseront pas faire(...)" [8]. De fait les libres se soulèvent dans plusieurs endroits de l'Ouest et du Sud et remportent des victoires dès l'été 1791. Dirigés par Jacques Beauvais et André Rigaud, les mulâtres prennent même la capitale Port-au-Prince, qui est en grande partie incendiée, en novembre 1791.
La révolte des Noirs et l'abolition de l'esclavage
Le marronnage, favorisé par le relief montagneux de Saint-Domingue qui offre refuge aux esclaves en fuite, s'instaure dès le début de la traite. Les Noirs réussirent à vivre en groupes dans les forêts. Ils y développent une religion syncrétique des croyances africaines, le vaudou. Le phénomène perdure malgré la traque et la répression féroce. Ces marrons inquiètent les Blancs qu'ils empoisonnent parfois et dont ils brûlent les champs.
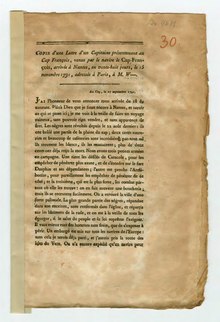
Le , à Bois-Caïman, dans la plaine du Nord, de nombreux esclaves décident la révolte, sous l'autorité de Boukman, assisté de Jean-François et Biassou. Ce premier acte de la révolution des esclaves aurait pris la forme d'une cérémonie vaudoue, où en présence de la mambo Cécile Fatiman, un pacte de sang est signé dans le sacrifice d'un cochon noir créole. En quelques jours, toutes les plantations du Nord sont en flammes, et un millier de Blancs massacrés. Malgré la répression où Boukman est tué, des bandes d'esclaves armés persistent dans les campagnes et les montagnes. Dans d'autres parties du pays, des révoltes plus spontanées s'ensuivent. Dès le début de la révolution, les participants au grand soulèvement des esclaves, qui commence en 1791 à Saint-Domingue, proclament leur loyauté au roi et à la religion[9]. La nuit du 22 au 23 août, les esclaves prennent les armes. Les insurgés gagnent du terrain, mais la révolution se prolonge. Les insurgés comptent de valeureux guerriers mais qui n'ont aucune expérience de l'exercice du pouvoir.
La nouvelle arrive seulement à Paris le 27 octobre 1791. Le soulèvement des esclaves entraîne de vifs débats à la nouvelle Assemblée législative de Paris. Celle-ci se rallie progresseivemnt et avec difficulté aux arguments insistants des Girondins ou de leurs proches comme Brissot, Condorcet, Pierre Vergniaud, Élie Guadet, Armand Gensonné, Jean-Francois Ducos et de Jean-Philippe Garran de Coulon. Ceux-ci appellent à l'égalité de tous les hommes libres, quelle que soit leur couleur de peau pour vaincre dans l'immédiat les esclaves insurgés. Le 24 mars 1792 est enfin promulgué ce décret égalitaire. Il est sanctionné par le roi, Louis XVI, le 4 avril grâce sans doute à une intervention auprès de lui du nouveau minstre de l'intérieur, Etienne Clavière. L'accord royal est imposé par la constitution de 1791. Le 25 mars 1792 dans La Chronique de Paris, Condorcet demande timidement à ce qu'"au nom de l'Humanité les intêrets des Noirs (esclaves) ne seront pas entièrement oubliés"[10]. Un petit nombre de députés ont soutenu résolument à son annonce l'insurrection d'esclaves, assimilée par eux à la prise de la Bastille par les Parisiens. Ainsi en est-il le 6 novembre 1791, de Merlin de Thionville, de Jacques Brival au club des jacobins le 4 décembre, à l'assemblée législative le 6, puis quelques jours plus tard, par la présentation d'un vaste plan d'abolition, de Mathieu Blanc-Gilli ; enfin entre août et novembre 1792 de Joseph Lequinio dans Les Préjugés Détruits[11]. Hors de l'assemblée la révolte d'esclaves est soutenue avec ferveur par Chaumette dans Les Révolutions de Paris, dans une moindre mesure par Jean-Paul Marat dans l'Ami du Peuple, par Millin et Francois Noel (ce dernier, ancien membre de la Société des Amis des Noirs), dans La Chronique de Paris [12]; ou encore par l'ancien constituant, Dubois-Crancé, dans un portrait élogieux de son ancien collègue antiesclavagiste, Pétion (Véritable Portrait de nos Législateurs)[13]. Le rôle personnel de Maximilien Robespierre sur ces questions est encore sujet à débat [14]. En mai 1792 dans Le Défenseur de la Constitution il salue le combat des Girondins en faveur de la liberté dans les colonies, précisant qu'il s'agit à ses yeux de l'unique aspect positif de leur bilan législatif et à ce titre il regrette de ne pas les avoir vus manifester autant de zèle pour "le peuple français" que pour "le peuple de Saint-Domingue", qu'il limite aux 26.000 colons métis et Noirs affranchis de la colonie insurgée ; mais dont il admet implicitement "au nom de l'humanité" le bien-fondé de leur insurrection.[15] Seule Olympe de Gouges, qui réussit enfin à faire éditer en mars 1792 une de ses pièces de théâtre antiesclavagistes, Zamor et Mirza, grâce à l'élection en novembre 1791 à la mairie de Paris de Jérôme Pétion, condamne les insurrections des deux peuples de Saint-Domingue au nom de la non-violence.
« C’est à vous, actuellement, esclaves, hommes de couleur, à qui je vais parler ; j’ai peut-être des droits incontestables pour blâmer votre férocité : cruels, en imitant les tyrans, vous les justifiez (...) Quelle cruauté, quelle inhumanité ! La plupart de vos maîtres étaient humains et bienfaisants et dans votre aveugle rage vous ne distinguez pas les victimes innocentes de vos persécuteurs. Les hommes n’étaient pas nés pour les fers et vous prouvez qu’ils sont nécessaires. Je ne me rétracte point j’abhorre vos tyrans, vos cruautés me font horreur » [16].
Ces propos lui valent le persiflage par lettre en avril 1792 d'un Brissotin, le Procureur Syndic de la Commune adjoint du maire Pétion, Pierre Louis Manuel :
« ... Mme de Gouges a voulu aussi concourir à la rédemption des Noirs ; elle pourra trouver des esclaves qui ne veulent pas de leur liberté »[17].
Mais elle s'exprime peut-être de cette manière par haine absolue de la violence. Ainsi le 15 avril dans Le bon sens français ou l'apologie des vrais nobles, dédié aux Jacobins, elle donne raison à Robespierre dans son combat contre le bellicisme européen des Girondins :
..."mais il faut convaincre, et rendre à chacun la liberté de délibérer sur le sort de son pays […] voilà ma motion, et je m’oppose, comme M. Robespierre, au projet de la guerre pour cette décision."
Pour faire appliquer la loi du 4 avril 1792, de nouveaux commissaires civils, Léger-Félicité Sonthonax et Étienne Polverel, sont envoyés à Saint-Domingue, appuyés de quatre mille volontaires de la garde nationale. Après l'arrivée de la nouvelle du 10 août 1792, Biassou se nomme « vice-roi » en attendant la libération du roi de France[9]. Les nouveaux commissaires civils débarquent au Cap le , à la veille de la proclamation de la République française. Sonthonax annonce à son arrivée qu'il entendait préserver l'esclavage. Mais c'est lui qui avait écrit un an plus tôt : « Les terres de Saint-Domingue doivent appartenir aux Noirs. Ils les ont acquises à la sueur de leur front » et il ne reçoit que défiance de la part des colons. Les commissaires s'allient aux mulâtres pour s'imposer. Ils rencontrent du succès, notamment à Port-au-Prince. Le au Cap-Français, le nouveau gouverneur Galbaud s'allie aux colons pour renverser les commissaires. Acculés, ceux-ci promettent la liberté à tout esclave qui se battrait pour la République. Des hordes envahissent la ville, la pillent et l'incendient. Dix mille colons s’expatrient. De leur côté, l'Angleterre et l'Espagne, qui avaient déclaré la guerre à la France, attaquent Cap-Français par la mer et par les terres depuis la partie orientale de l'île, possession espagnole. Les Espagnols ont avec eux des colons royalistes ainsi que des bandes d’esclaves révoltés, comme celle de Jean-François et de Biassou, à qui ils ont promis la liberté. À l'été 1793, de nombreux ports et la plus grande partie du pays sont occupés.
À la recherche d'alliés, Sonthonax proclame de son propre chef l'abolition de l'esclavage le dans le Nord de l'île. Un mois plus tard, Polvérel fait de même dans le reste du pays. Afin de faire avaliser cette décision, les commissaires civils choisissent trois députés, l'un Blanc, l'autre mulâtre, le troisième Noir — Jean-Baptiste Belley — qu'ils envoient à Paris. Devant le rapport de ces députés, la Convention vote, dans l'enthousiasme, le , la fin de l'esclavage sur l'ensemble de l'île de Saint-Domingue et l'étend aux autres colonies sur demande de René Levasseur, de Jean-François Delacroix, de l'abbé Henri Grégoire, de Joseph Cambon et de Georges Danton. Deux journaux, le Républicain de Charles Duval et le Créole Patriote de Claude Milscent, relatent de manière détaillée la soirée du 16 Pluviôse an II au club des Jacobins[18]. Les trois députés de Saint-Domingue sont accueillis à la Société, présidée par Jacques Reverchon qui leur donne l'accolade, et où Saint-Paul, Nicolas Maure, Philibert Simond, Antoine-François Momoro, Charles Duval débattent des conditions d'inscription. Le 23 germinal an II-12 avril le comité de salut public nomme une commission dans un décret signé par Barère, Collot d'Herbois, Carnot, Billaud-Varenne. La Convention montagnarde ne s'en tient pas là. Le 17 ventôse an II-7 mars 1794 sur demande de Dufay, Belley et Mills et par un décret signé Collot d'Herbois et Saint-Just, le Comité de Salut Public fait arrêter deux colons blancs de Saint-Domingue, Page et Brulley qui intriguaient contre eux. Toujours sur leur demande le 11 avril, au CSP Barère, Carnot, Collot d'Herbois et Robespierre signent l'éviction d'un ami de Page et Brulley à la tête de la commission, Simondes. Entretemps le 19 ventôse an II-9 mars tous les autres colons de Saint-Domingue sont apréhendés par la Convention. Mais Page et Brulley gardent à la Convention un autre allié en la personne du député métis de la Martinique, Janvier Littée qui faisait distribuer un pamphlet contre la députation de Saint-Domingue. En messidor an II-juin et juillet 1794 par l'intermédiaire de l'agent Claude Guérin, Robespierre, Couthon, Jeanbon Saint-André le mettent sous surveillance. Cependant Julien Raimond et Leborgne restent en prison.
Toussaint Louverture et la révolution noire
La Convention Montagnarde n'avait pas accèdé à la demande de Bourdon de l'Oise d'abroger son décret de mise en accusation de Sonthonax et de Polverel voté le 16 juillet 1793 ce jour là après intervention de Billaud-Varenne. Ce fut Jean-Jacques Bréard qui les fit réhabiliter le 25 octobre 1795 par la Convention Thermidorienne [19]. Le décret du 16 Pluviôse an II fut sans doute la seule mesure votée par la Convention montagnarde, qu'après juillet 1794 les Thermidoriens, puis le Directoire ne mirent pas en cause. Parmi les tombeurs montagnards de Robespeirre nombre d'entre eux étaient des antiesclavagistes déclarés : Dubois-Crancé, Merlin de Thionville, Collot d'Herbois, Brival, Bourdon de l'Oise, Cambon, Charles Duval, Carnot, Barère, Billaud-Varenne ; et même parmi les plus dangereux ennemis de Robespierre, les représentants en mission Tallien et Fouché qu'il avait fait rappeler de Bordeaux et de Lyon pour leurs crimes et rapines [20]. Le décret fut même inscrit en 1795 dans la constitution de l'an III : les colonies devenaient des départements. Dans un rapport sur les colonies Boissy d'Anglas salua l'unique mesure positive à ses yeux prise par "la tyrannie". Et en 1799 Garran-Coulon rendit un hommage similaire au rôle de Danton, que pourtant les thermidoriens s'étaient refusés en 1795 à réhabiliter comme victime de Robespierre. Dans cette opitique en 1796 fut créée par des survivants de la société des Amis des Noirs tels que Lanthenas, Grégoire, Benjamin-Sigismond Frossard, Joseph Servan, ainsi que par d'autres antiesclavagistes d'horizons politiques divers comme Garran-Coulon, Jean-Baptiste Say, Charles Duval, Jacques Duplantier, Etienne Laveaux une deuxième société, la Société des Amis des Noirs et des Colonies. Elle avait pour but la consolidation du décret philanthropique et de la départementalisation de Saint-Domingue [21]. Mais dans un souci de concorde à l'instar de Julien Raimond et de Leborgne les colons esclavagistes de Saint-Domingue furent libérés après Thermidor.

Avant comme après Thermidor on pensa à l'intégration linguistique de la colonie. Le 16 Prairial an II-4 juin 1794 Grégoire avait inséré dans son célèbre rapport sur l'anéantissement des patois l'émancipation linguistique coloniale qu'imposait la langage infinitif des Noirs :
« Les nègres de nos colonies dont vous avez fait des hommes, ont une espèce d'idiome pauvre comme celui des Hottentots, comme la langue franque qui dans tous les verbes ne connaît guère que l'infinitif ».
L'affranchi Toussaint Bréda — du nom de la plantation au Haut-du-Cap où il est né en 1743 — exerce, malgré sa petite taille, un ascendant, tant par ses origines africaines qu'on dit royales d'Allada que par ses qualités de lettré, de cavalier et de médecin par les plantes (docteur feuilles).
Il devient aide de camp de Georges Biassou, l'un des successeurs de Boukman, qui se rallie aux Espagnols de l'Est de l'île en 1793, afin de combattre les colons. Initié à l'art de la guerre, il remporte plusieurs victoires audacieuses qui lui valent le surnom de « L'Ouverture ».
L'abolition de l'esclavage par les commissaires civils le fait réfléchir. Après un échange de courriers avec le général républicain Étienne Lavaux, il change brutalement de camp en . En quelques mois, il refoule les Espagnols à la frontière orientale de l'île et bat les troupes de ses anciens chefs qui leur sont restés fidèles. En 1795, il libère l'intérieur des terres. La Convention l'élève au grade de général en juillet. En mars 1796, le gouverneur Laveaux, qu'il a délivré d'une révolte au Cap, le nomme lieutenant-général de Saint-Domingue.
À mesure de ses victoires, Toussaint confirme l'émancipation des esclaves. Grâce aux renforts arrivés de métropole en mai 1796, il reprend la lutte contre les Anglais qui tiennent de nombreux ports. Lassés d'un combat sans espoir, ceux-ci finissent par négocier directement avec lui et abandonnent Saint-Domingue le .
Toussaint a, en effet, éloigné les représentants de l'autorité métropolitaine, y compris Lavaux en octobre 1796, et Sonthonax en août 1797, pourtant revenu comme commissaire civil. Il a habilement fait élire ces derniers députés de Saint-Domingue à Paris. Le dernier commissaire envoyé par le Directoire, le général Hédouville, embarque en octobre 1798, après avoir constaté que l'armée n'obéit qu'à Toussaint. A Paris, en février 1796 se créé une deuxième Société des Amis des Noirs la Société des Amis des Noirs et des Colonies, chargée de consolider le décret de Pluviôse an II. Garran-Coulon, Lanthenas et l'abbé Grégoire en sont les principaux fondateurs.
Les mulâtres, menés par le général André Rigaud, sont les derniers à discuter son autorité. Ils tiennent le Sud du pays. Avec l'aide de ses lieutenants Christophe et Dessalines, Toussaint les bat en août 1800 après une guerre civile sanglante d'un an. Rigaud embarque pour la France.
Enfin, après avoir envahi en un mois la partie espagnole de Saint-Domingue, en janvier 1801, il établit son autorité sur toute l'île.
Toussaint organise la remise en marche de l'économie en invitant les colons à revenir, y compris ceux qui ont choisi le parti contre-révolutionnaire. Il publie, le , un règlement de culture obligeant les Noirs à reprendre le travail sur les plantations. Ce travail forcé est mal perçu par la population. En novembre 1801, une révolte éclate dans les ateliers du Nord. Il la mate et fait fusiller treize meneurs, dont son neveu adoptif, le général Moyse.
Le , il promulgue une constitution autonomiste (Constitution de Saint-Domingue de 1801) qui lui donne les pleins pouvoirs à vie.
La reconquête française et la guerre d'indépendance

En représailles, Napoléon Bonaparte, qui signe avec l'Angleterre les préliminaires de la paix d'Amiens le , charge une expédition militaire de reprendre le contrôle de l'île. Composée de plusieurs escadres, réunissant au total trente et un mille hommes à bord de quatre-vingt-six vaisseaux, elle est menée par le général Leclerc, beau-frère de Napoléon.
Toussaint arrête une stratégie de défense de marronnage : lorsque Leclerc arrive au port du Cap en février 1802, il donne un ultimatum de vingt-quatre heures au général Henri Christophe pour lui rendre la ville. Christophe lui répond alors ainsi : « Je ne vous livrerai la ville que lorsqu'elle sera en cendre et sur ces mêmes cendres je combattrai encore ». Les villes sont incendiées et les troupes locales se retirent sur les hauteurs pour pratiquer une guerre d'usure. Les Français investissent le plus souvent des villes en ruines, comme au Cap. Les Noirs résistent, mais reculent devant la puissance de l'armée de Leclerc. À la fin avril, au prix de cinq mille morts et autant de malades ou blessés, les Français tiennent toute la côte.
Les généraux de Toussaint Louverture, dont Henri Christophe (en avril) et Jean-Jacques Dessalines, lors du siège de la Crête à Pierrot, près de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, après trois semaines de combat inégal et sanglant en mars 1802 — se rendent aux Français après d'âpres combats, si bien que Toussaint Louverture lui-même accepte sa reddition en mai 1802. Il est autorisé à se retirer sur l'une de ses plantations, à proximité du bourg d'Ennery, dans l'ouest de l'île, non loin de la côte. Plus tard, en partant pour la France, Toussaint prononcera ces paroles : « En me renversant on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des noirs qui repoussera par ses racines car elles sont profondes et nombreuses. »
Napoléon promulgue la Loi du 20 mai 1802 qui maintient l'esclavage dans les colonies françaises où il n'avait pu être aboli, ces dernières étant passées sous domination anglaise (Sainte-Lucie, Tobago et Martinique).
Le 7 juin 1802, Toussaint Louverture est arrêté malgré sa reddition et Jean-Jacques Dessalines, défait par les Français à la Crête-à-Pierrot, participe à cette arrestation[22]. Louverture est déporté en France, il est interné au fort de Joux, dans le Jura, où il mourra des rigueurs du climat et de malnutrition le 7 avril 1803, après avoir prophétisé la victoire des Noirs.
Toussaint Louverture neutralisé, Leclerc décide le désarmement de la population et le met en œuvre à grand renfort d'exécutions sommaires ; alors, les chefs de couleur se détachent peu à peu de l'expédition de Saint-Domingue et rejoignent les insurgés, prenant conscience que l'expédition de Saint-Domingue n'avait d'autre but plus important que celui de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue.
C'est en apprenant le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe qu'Alexandre Pétion donne le signal de la révolte, le 13 octobre 1802. À la tête de cinq cent cinquante hommes, il marche contre le principal poste français du Haut-du-Cap, le cerne, le fait désarmer et sauve quatorze canonniers que les siens voulaient égorger : l'armée des « indépendants » est alors formée. Les généraux Geffrard, Clervaux et Christophe viennent se joindre à Pétion, qui accepte de céder au dernier le commandement de l'insurrection.
Dessalines rejoint alors de nouveau les révoltés, dirigés par Pétion, en octobre 1802. Au congrès de l'Arcahaie (15-18 mai 1803), Dessalines réalise à son profit l'unité de commandement. C'est lors de ce congrès que naît le premier drapeau haïtien, bicolore bleu et rouge, inspiré du drapeau français dont la partie blanche — considérée comme symbole de la race blanche et non pas de la royauté — a été déchirée. Le 19 novembre 1803, à la tête de l'armée des indigènes, avec à ses côtés Henri Christophe, il impose à Rochambeau — le successeur de Leclerc (mort de la fièvre jaune en novembre 1802) qui utilisait contre les insurgés des chiens de guerre achetés à Cuba, censés être entraînés à chasser et manger les Noirs mais qui ne feront pas la différence — la capitulation du Cap après la défaite des 2 000 rescapés du corps expéditionnaire français décimé par la fièvre jaune face à plus de 20 000 insurgés à la bataille de Vertières. Rochambeau capitule et négocie l'évacuation de l'île sous 10 jours.
Après le départ des Français, Dessalines provoque aussitôt le massacre de la population blanche restante et des métis[23] à l'exception des prêtres, médecins, techniciens. Il redonne à Saint-Domingue son nom indien d'Haïti (Ayiti) et proclame la République le 1er janvier 1804 aux Gonaïves.
La première république noire libre du monde vient alors de naître.
Les caractères fondateurs de la révolution haïtienne
Pour Leslie Manigat [réf. nécessaire], la révolution haïtienne est novatrice en dix points spécifiques. Cette histoire est un point de vue uniquement, elle ne tente pas d’être absolue et universelle. C’est :

- une révolution servile violente et, cas rare dans l’Histoire, victorieuse ;
- la première abolition de l'esclavage en Amérique, amorce d'une série d’abolitions se terminant en 1888 au Brésil ;
- la deuxième indépendance en Amérique après les États-Unis.
- émancipation noire identifiée comme telle ;
- réforme agraire du Nouveau Monde ;
- essai expérimental de la formule de self-government comme étape intermédiaire dans l’histoire de la colonisation ;
- affirmation du tiers-mondisme avant la lettre ;
- expression de la problématique race-classe résolue par le primat de la race sur la classe pour la libération nationale ;
- victoire militaire d’un pays extra-européen sur une armée européenne, jamais vue depuis les Grandes découvertes (il faudrait excepter celle des « Caraïbes noirs » sur les Français, à Saint-Vincent en 1719) ;
- promotion charismatique d’un chef noir.
Conclusion
Le bilan de l'expédition de Saint-Domingue est particulièrement lourd en vies humaines. À la veille de la révolution, la population de l'île compte environ 550 000 âmes. En 1804, elle est réduite à 300 000.
Selon Claudia E. Sutherland, de l'Université de Washington, 100 000 Noirs sur une population de 500 000 et 24 000 Blancs, sur une population de 40 000, sont morts au terme du conflit[24].
Il faut attendre 1825 pour que la France de Charles X « concède » l'indépendance à Haïti, moyennant le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or pour « dédommager les anciens colons ». Renégociée en 1838 à 90 millions (17 milliards d'euros en 2012), cette dette d'indépendance a été entièrement honorée par versements successifs jusqu'en 1883. Cependant, le versement des agios de l'emprunt généré par cette dette s'étalera jusqu'au milieu du XXe siècle. Selon Louis-Philippe Dalembert, cette dette aura contribué à la grande pauvreté qui touche encore le pays[25].
L'indépendance d'Haïti marque la fin du colonialisme, mais installe au pouvoir l'élite de l'armée haïtienne, surtout constituée d'anciens affranchis. Cette élite se divise bientôt en deux factions : les défenseurs d'Alexandre Pétion, principalement mulâtres, et ceux d'Henri Christophe, largement noirs. Ces deux factions, constituant une classe citadine occidentalisée, se disputent le pouvoir tout au long du siècle, sans laisser de véritable place aux descendants des esclaves à culture rurale et vaudoue, relégués dans ce que le sociologue Gérard Barthélemy appelle « le pays en dehors ».
Les conséquences dans la Caraïbe
Dans le monde atlantique, toute rumeur d’esclaves en révolte ou menace d’agitation politique s’accompagnait de la référence à Haïti[26]. Près de 20 000 réfugiés français de Saint-Domingue vinrent s'installer dans la région de Santiago de Cuba, qui restera un bastion de l'opposition à la nouvelle république d'Haïti, qui était géographiquement toute proche, à seulement 60 kilomètres en bateau. Après les émeutes anti-françaises de mars 1809 à Cuba, la plupart durent fuir à La Nouvelle-Orléans, pour grossir les rangs des réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique.
La révolution haïtienne est en particulier montrée du doigt, tout en suscitant des espoirs, lorsque Pétion en fit une base de repli pour les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine. Lorsque Simón Bolívar revint en Haïti en septembre 1816, après avoir été battu en juillet à Ocumare et avoir perdu son armée, le gouverneur Escudero installé à Santiago de Cuba fut le premier à informer le général espagnol Pablo Morillo, chef de l'expédition pacificatrice à destination du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade du risque couru[27].
Notes et références
- Thomas Madiou, Histoire d'Haïti, Tome I, p. 313.
- http://lencrenoir.com/23-aout-1791-revolte-des-esclaves-a-saint-domingue-haiti-une-rememoration-dune-lutte-pour-la-liberte/.
- Jacques Thibau, Le temps de Saint-Domingue ; l'esclavage et la révolution française Paris, Jean-Claude Lattès, 1989 p. 187
- Florence Gauthier, " Julien Raimond dans la formation du nouveau peuple de Saint_Domingue 1789-1793" Marcel DORIGNY (dir), Esclavage, résistances, abolitions ; Paris, Ed. du C.T.H.S., 1999, p.223-233
- Jean-Daniel Piquet, L'Emancipation des Noirs dans la révolution française 1789-1795, Paris, Karthala, 2002, chapitres 2 et 3.
- Jean-Daniel Piquet, L'Emancipation des Noirs dans la révolution française 1789-1795, Paris, Karthala, 2002, p. 109-120
- Jean-Daniel Piquet, L'Emancipation des Noirs dans la révolution française 1789-1795, Paris, Karthala, 2002 p. 163-166
- Oeuvres de Marat, tome 6 ; Jean-Daniel Piquet, L'Emancipation des Noirs..., p.210
- Jeremy D. Popkin, « Colonies françaises », dans Jean-Clément Martin (dir.), Dictionnaire de la Contre-Révolution, Perrin, 2011, p. 185.
- Yves Benot, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, La Découverte, 1987-2004, p.150
- Jean-Daniel Piquet, L'émancipation des Noirs dans la Révolution française 1789-1795 Paris, Karthala, 2002 pour les détails du plan de Mathieu Blanc-Gilli voir Jean Jaurès, Histoire socialiste de la révolution française tome 2, La législative
- Yves Benot, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, La Découverte, 1987-2004, p.135-156
- Jean-Daniel Piquet, L'émancipation des Noirs dans la révolution française (1789-1795), Paris, Karthala, 2002, p. 174-179
- Robespierre et la liberté des noirs en l’an II d’après les archives des comités et les papiers de la commission Courtois, Jean-Daniel Piquet, https://journals.openedition.org/ahrf/1822
- Jean-Daniel Piquet, L'émancipation des Noirs dans la révolution française 1789-1795, Paris, Karthala, 2002, p. 155 ; Oeuvres de Robespierre, tome 4, p. 84
- Olympe de Gouges, Zamor et Mirza, Paris, Edition Côtes femmes, 1989, préfacée par Eleni Varikas.
- Jean-Daniel Piquet, L'Emancipation des Noirs..., p. 139.
- Jean_Daniel Piquet, L'émancipation des Noirs..., chap. XIV
- Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en révolution 1789-1795-1802, Paris PUF, 1992
- Dans ces villes Tallien et Fouché fêtèrent le décret d'abolition de l'esclavage les 18 février et 10 mars 1794
- Marcel Dorigny, Bernard Gainot, La Société des Amis des Noirs (1788-1799), Contribution à l’histoire de l’abolition de l’esclavage, Ed. Unesco, 1998
- Victor Schœlcher, Vie de Toussaint Louverture, P. Ollendorff, 1889, p. 348.
- Jean-Marcel Champion, notice biographique consacrée à « Jean-Jacques Dessalines » dans le Dictionnaire Napoléon, op. cit., p. 599.
- Claudia E. Sutherland, Haitian Revolution (1791-1804), blackpast.org.
- France Info, Haïti: le poids d'une dette vieille de 200 ans, 11/06/2016
- http://www.cairn.be/article.php?ID_ARTICLE=ANNA_582_0333&AJOUTBIBLIO=ANNA_582_0333.
- Alain Yacou, Essor des plantations et subversion antiesclavagiste à Cuba, 1791-1845, KARTHALA Editions, , 396 p. (ISBN 9782811104016, lire en ligne)
Voir aussi
Sources
- Thomas Madiou, Histoire d'Haïti, Tome I, [lire en ligne].
- Victor Schœlcher, Vie de Toussaint Louverture, Éditions Karthala, (réimpr. 1982).
- Lucien-René Abenon, Jacques de Cauna, Liliane Chauleau, Antilles 1789 - La Révolution aux Caraïbes, Paris, Nathan, 1989.
- Gérard Barthélémy, L'Univers rural haïtien : le pays en dehors, Paris, L'Harmattan, 1991 (ISBN 2-7384-0840-0).
- Yves Benot, La révolution française et la fin des colonies, Paris, La Découverte, 1987-2004
- François Blancpain, La Colonie française de Saint-Domingue, Paris, Karthala, 2004 (ISBN 2-84586-590-2).
- Justin Chrysostome Dorsainvil, Manuel d'Histoire d'Haïti, Port-au-Prince, 1929.
- Laurent Dubois, Les Vengeurs du Nouveau Monde. Histoire de la Révolution haïtienne, Rennes, Les Perséides, 2005 (ISBN 978-2-915596-13-7).
- Carolyn Fick, Haïti, naissance d'une nation. La Révolution haïtienne vue d'en bas, Rennes, Les Perséides, 2013.
- Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en révolution 1789-1795-1802, Paris PUF, 1992
- Philippe R. Girard, Ces esclaves qui ont vaincu Napoléon. Toussaint Louverture et la guerre d’indépendance haïtienne (1801-1804), Rennes, Les Perséides, 2013.
- Alejandro E. Gómez, Le Spectre de la révolution noire. L'impact de la révolution haïtienne dans le monde atlantique, 1790-1886, Rennes, PUR, 2013.
- Jean Jaurès, Histoire socialiste de la révolution française, tome 2, Editions sociales, 1968 La Législative.
- Jean-Daniel Piquet, L'Emancipation des Noirs dans la révolution française 1789-1795, Paris, Karthala, 2002.
- Jacques Thibau, Le temps de Saint-Domingue ; l'esclavage et la révolution française Paris, Jean-Claude Lattès, 1989.
Œuvres de fiction
- Romans :
- Alejo Carpentier, El reino de este mundo, 1949, en français Le Royaume de ce monde.
- Jean-Baptiste Picquenard, Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale, 1798.
- Victor Hugo, Bug-Jargal, 1819 et 1826. Ce premier roman de l'auteur est inspiré en partie de Adonis, ou le bon nègre.
- Madison Smartt Bell, Le soulèvement des âmes [« All Souls' Rising », 1995], trad. de Pierre Girard, Arles, France, Actes Sud, 1999, 597 p.
- Isabel Allende, L'Ile sous la mer, 2011.
- Film : Gillo Pontecorvo, (en) Burn!, en français Queimada, 1969.
- Théâtre : Heiner Müller, La Mission, souvenir d'une révolution, 1979.
Articles connexes
- Expédition de Saint-Domingue
- Décolonisation des Amériques
- Histoire d'Haïti
- Saint-Domingue (colonie française)
- Chronologie de l'esclavage


