John Cage
| Nom de naissance | John Milton Cage |
|---|---|
| Naissance |
Los Angeles |
| Décès |
New York |
| Activité principale | compositeur |
| Style | Musique contemporaine, expérimentale et minimaliste. |
| Activités annexes | philosophe, poète, plasticien |
| Collaborations | David Tudor, Merce Cunningham |
| Maîtres | Arnold Schönberg, Henry Cowell, Lazare-Lévy |
| Conjoint | Merce Cunningham |
Œuvres principales
- Sonates et interludes
- The Wonderful Widow of Eighteen Springs1992
- Concerto pour piano et orchestre
Biographie

rt au Yi King pour composer aléatoirement Music of Changes en 1952, pour piano seul. Créer cette pièce lui prend neuf mois, il tire au sort chaque composante du son afin d'élaborer sa partition.
Cage a aussi fait figure d’enseignant dans les années 60, dans certaines écoles américains telles que le Black Mountain College et la New School for Social Research, permettant de développer et de transmettre une remise en question du statut de l’oeuvre d’art et de l’artiste dans le monde de l’art du XXe siècle.
L'une des œuvres les plus célèbres de John Cage est probablement 4′33″, un morceau où un(e) interprète joue en silence pendant quatre minutes et trente-trois secondes. Composée en trois mouvements devant relate dans son « Journal » qu'il est plus intéressant d'écouter les sons de la natureeux sons persistent : les battements de son cœur et le son aigu de son système nerveux ». Comme le dit Yoko Ono, John Cage « considérait que le silence devenait une véritable musique »[réf. nécessaire].
À partir de cette période, toutes les compositions de Cage seront conçues comme des musiques destinées à accueillir n'importe quel son qui arrive de manière imprévue dans la composition.
Son œuvre
Cage composa de nombreuses pièces pour piano préparé dont les Sonates et interludes, où le pianiste doittrangeté de ses compositions laisse transparaître l'influence du compositeur Erik Satie, auteur en son temps incompris de compositions très originales, comme les ésotériques Gnossiennes ou les très sobres et célèbres Gymnopédies. Cherchant à épurer sa musique, il eut la particularité d'écrire ses œuvres sans ponctuation musicale, laissant au pianiste comme seules indications des descriptions d'atmosphère au lieu des traditionnelles nuances.
Cage prétendait que l'une des composantes les plus intéressantes en art était en fait ce facteur d'imprévisibilité où des éléments extérieurs s'intégraient à l'œuvre de manière accidentelle[1]. Il considérait la plupart des musiques de ses contemporains « trop bonnes car elles n'acceptent pas le chaos »[2]. À partir de cette époque, il compose des musiques uniquement fondées sur le principe d'indétermination en utilisant différentes méthodes de tirage aléatoire dont le Yi Jing. Le mot « aléatoire » doit s'entendre chez John Cage, en anglais, comme chance et non pas random, autrement dit le hasard. Pour Cage, le mot "random" a une connotation négative que n'a pas "chances", il ne l'utilise donc pas dans ses écrits pour qualifier sa musique.[pas clair]
Le travail de John Cage s'appuie sur la recherche et l'expérimentation. Il fut lauréat du Prix de Kyoto en 1989.
Compositions
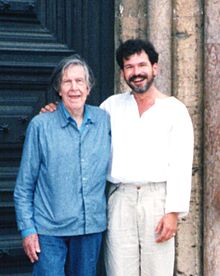
- First Construction in Metal (1939)
- Imaginary Landscape No. 1 (1939)
- Bacchanale (1940), première œuvre pour piano préparé.
- Living Room Music (1940), contenant notamment Story, avec un texte de Gertrude Stein.
- Primitive (1942)
- Credo In Us (1942)
- Amores (1943)
- Four walls (1944)
- Music for Marcel Duchamp (1947)
- Sonates et interludes (1948)
- Dream (1948)
- String Quartet in Four Parts (en) (1950)
- Music of Changes (1951)
- 4′33″ (1952)
- Williams Mix (en) (1952) avec Bebe et Louis Barron
- Radio Music (1956)
- Concert for Piano and Orchestra (1957-58)
- Fontana Mix (1958)
- Water Walk (1960)
- Cartridge Music (1960)
- Variations II (1961)
- 0'00 (4'33" No.2) (1962)
- Cheap Imitation (1969)
- HPSCHD (1969) en collaboration avec Lejaren Hiller[3]
- Song Books (1970)
- Bird Cage (1972)
- Branches (1976)
- Litany for the Whale (1980)
- Ryoanji (1983)
- But What About the Noise of Crumpling Paper (1985)
- Europeras 1 & 2 (1987)
- Organ²/ASLSP (As Slow As Possible) (1987)
- One8 (1991) pour violoncelle avec archet courbe
- Four5 (1992)
- One13 (1992) pour violoncelle avec archet courbe (avec Michael Bach)
Discographie
- Roaratorio: An Irish Circus on Finnegans Wake (1979) pour récitant, musiciens irlandais et magnétophone à 62 pistes. John Cage (voix), Joe Heaney (chanteur), Seamus Ennis (uillean pipes), Paddy Glackin (Fiddle), Matt Malloy (flûte) et Peadher Mercier et Mell Mercier (Bodhran).
Quelques musiques de film
- Music for Marcel Duchamp (1947) est utilisé dans la bande-son du film Shutter Island de Martin Scorsese (2010)
Autres activités
Passionné de mycologie, John Cage cofonda la New York Mycological Society[4].
Œuvres écrites
- Silence, trad. partielle Monique Fong, Denoël, coll. Lettres Nouvelles, 1970 et 2004; nouvelle traduction intégrale Vincent Barras, Héros-Limite, 2003, rééd. 2012.
- Correspondance avec Pierre Boulez, Christian Bourgois, 1991.
- John Cage par John Cage, Textuel, 1998.
- Richard Kostelanetz, Conversations avec John Cage, trad. Marc Dachy, Éditions des Syrtes, Paris 2000.
- Pour les oiseaux : Entretiens avec Daniel Charles, L'Herne, 2002.
- Je n'ai jamais écouté aucun son sans l'aimer : le seul problème avec les sons, c'est la musique, trad. Daniel Charles, La Main courante, 2002.
- Journal : comment rendre le monde meilleur (on ne fait qu'aggraver les choses), Héros-Limite, 2003.
- Une année dès lundi : Conférences et écrits, trad. Christophe Marchand-Kiss, Textuel, 2006.
- Confessions d'un compositeur, trad. Élise Patton, Allia, Paris, 2013.
- Rire et se taire. Sur Marcel Duchamp, Allia, trad. Jérôme Orsoni, 2014, 96 p.,
- Radio Happenings, avec Morton Feldman, Allia, trad. Jérôme Orsoni, , 2015.
- Autobiographie, Allia, éd. bilingue trad. Monique Fong, 2019.
Hommages
- Mapping the Studio II with Color Shift, Flip, Flop & Flip/Flop (Fat Chance John Cage), œuvre de Bruce Nauman (2001) dédiée à John Cage.
Notes et références
- Conversation entre Esther Ferrer et André Éric Létourneau, Actes du colloque « Création en milieu contraint », Biennale de Paris, Musée du quai Branly, Paris, 2009
- Entretien avec John Cage réalisé par Nathalie Laure, Radio de Radio-Canada, 1988
- Entretiens avec Daniel Charles, p. 167 à 171.
- Sarah Gottesman, « Why Experimental Artist John Cage Was Obsessed with Mushrooms », sur Artsy.net, (consulté le )
Annexes
Bibliographie
- Bischoff, Ulrich (Hg.): Kunst als Grenzbeschreitung: John Cage und die Moderne, cat. exhib. Staatsgalerie moderner Kunst, München 1991
- Antonia Rigaud, John Cage, théoricien de l'utopie, L’Harmattan, 2006
- Anne de Fornel, John Cage, Éditions Fayard, 2019
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressources relatives aux beaux-arts :
- Art Institute of Chicago
- Art UK
- Artists of the World Online
- Auckland Art Gallery
- Bénézit
- Bridgeman Art Library
- Collection de peintures de l'État de Bavière
- Delarge
- Grove Art Online
- Kunstindeks Danmark
- Musée national centre d'art Reina Sofía
- Musée Städel
- Museum of Modern Art
- National Gallery of Art
- RKDartists
- Smithsonian American Art Museum
- Tate
- Union List of Artist Names
- Ressources relatives à la musique :
- Ressources relatives au spectacle :
- Ressources relatives à l'audiovisuel :
- Ressources relatives à la littérature :
- Ressource relative à plusieurs domaines :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- American National Biography
- Britannica
- Brockhaus
- Den Store Danske Encyklopædi
- Deutsche Biographie
- Enciclopedia italiana
- Enciclopedia De Agostini
- Gran Enciclopèdia Catalana
- Hrvatska Enciklopedija
- Nationalencyklopedin
- Munzinger
- Proleksis enciklopedija
- Store norske leksikon
- Treccani
- Universalis
- Visuotinė lietuvių enciklopedija
- Artiste contemporain américain
- Compositeur américain de musique classique de la période contemporaine
- Compositeur américain de ballet
- Compositeur américain de musique de film
- Musicien expérimental américain
- Art sonore
- Artiste sonore
- Fluxus
- Artiste d'ECM Records
- Artiste de Music & Arts
- Lauréat du prix de Kyoto
- Boursier Guggenheim
- Élève d'Arnold Schönberg
- Naissance en septembre 1912
- Naissance à Los Angeles
- Décès en août 1992
- Décès à New York
- Décès à 79 ans


